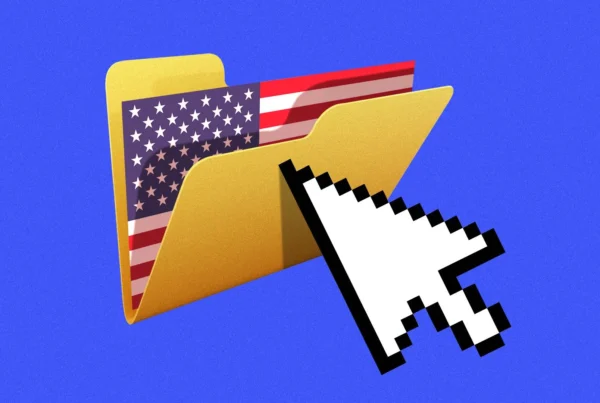De Bohemian Rhapsody à Blonde en passant par The Imitation Game, les biopics constituent un genre cinématographique à part entière connaissant une popularité grandissante.
Ces films, retraçant l’histoire d’une personne réelle et mettant en scène les événements marquants de sa vie, sont apparus dès les débuts du cinéma avec des réalisations telles que L’Exécution de Marie, reine des Écossais (1895). Plus d’un siècle plus tard, les biopics restent une valeur sûre pour les cinéastes, un succès presque assuré. Rien qu’en 2024, les vies d’Amy Winehouse, Charles Aznavour, Bob Marley et Bob Dylan ont été mises en scène. Néanmoins, malgré leur succès, les biopics sont-ils toujours un pari critique et populaire gagnant pour les cinéastes ?
Plaire à tout le monde : la recette du succès ?
Premier possible problème de ce genre : la version édulcorée. En effet, étant donné que ces productions hollywoodiennes mettent des millions de dollars en jeu, les studios n’ont souvent pas le droit à l’erreur. Afin de garantir le succès d’un film, tout le monde doit être satisfait du résultat.
Cette approche au biopic amène souvent une version iconisée et édulcorée des personnes mises en scène, omettant parfois des aspects plus nuancés de leurs vies, tels que leurs défauts. C’est le cas d’un biopic récent, dont le succès au box office reflète cette envie d’être irréprochable. En effet, Bohemian Rhapsody aborde la vie de Freddie Mercury, et revient sur les éléments clés de sa carrière en érigeant l’artiste en légende. Toutefois, le cinéaste Bryan Singer se garde bien de nous montrer les aspects plus sombres de la vie de l’artiste et occulte en partie ses addictions profondes à la drogue, au sexe et à l’alcool, rendant certaines parties du film invraisemblables.
Ce problème s’intensifie lorsque la réalisation du film est influencée par les proches de la personne mise en scène. La réalisatrice Sheila Bernard Curran affirme qu’obtenir l’autorisation de la famille, c’est le risque “d’aboutir à un film qui satisfait tout le monde mais que personne ne veut voir”. En effet, l’implication d’un proche mène souvent à une représentation positive et simpliste de l’artiste. Ce fut le cas du film Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, validé par le collaborateur et partenaire d’Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé. Le résultat était prévisible : une version lisse du couturier qui n’aborde pas ses problèmes de santé, d’alcool et de drogue, ni même son caractère nerveux et mélancolique.
Un récit chronologique : une bonne idée ?
Une autre erreur classique des biopics est de plonger dans un récit sans âme et sans point de vue. En effet, avoir un angle est fondamental pour aborder la vie d’un personnage de manière cinématographique. Par exemple, dans Amadeus, la vie de Mozart est abordée à travers les yeux de son rival, Antonio Salieri. C’est également le cas du film I’m Not There, dans lequel chaque période de la vie de Bob Dylan est interprétée par un acteur différent. Ces choix narratifs permettent de briser la monotonie d’un récit linéaire en permettant plus de dynamisme.
Sans ce type de point de vue, l’œuvre manque souvent d’efficacité narrative en se concentrant sur un récit chronologique trop strict qui s’apparente à la page Wikipédia de la personne représentée. Sans angle, le film ressemble plus à une reconstitution historique ou un documentaire qu’à une vraie proposition artistique basée sur la vision et l’imagination du réalisateur. Le film I Wanna Dance with Somebody, qui dépeint la vie de la légendaire Whitney Houston, est construit chronologiquement. Pendant près de 2h30, toute la vie de la chanteuse et actrice est exposée, de son enfance à sa mort, sans jamais aller en profondeur dans ses histoires d’amour, ses processus créatifs ou ses problèmes de drogue. En somme, selon nombre d’experts, c’est un film qui raconte à la fois tout et rien, jugé indigne de l’artiste qu’il met en scène et peu mémorable pour l’audience.
Champions de la diversité ?
Un potentiel danger des biopics réside dans leurs représentations des femmes et des minorités. En effet, une grande différence existe dans la représentation des célébrités. D’une part, les biopics féminins s’attardent souvent sur la sexualité des personnages représentés et sur leurs souffrances. Blonde, qui aborde la vie de Marilyn Monroe, dépeint l’actrice à succès comme une victime, constamment vue à travers ses relations amoureuses ou l’absence paternelle qu’elle a vécue. L’intelligence, le travail et la ténacité de Marilyn Monroe y sont éclipsés, au profit d’une représentation amplifiée de ses traumatismes. Ce type de portrait est en contraste majeur avec les biopics masculins, qui mettent le plus souvent en scène la « success story » des personnages plutôt que leurs difficultés. Ainsi, des films comme Monsieur Aznavour ou Elvis se concentrent sur le parcours et le travail acharné de ces artistes pour atteindre la célébrité.
Quant à la représentation d’artistes LGBT, leur sexualité est souvent mise en retrait, voire occultée. Ainsi, L’Extase et l’Agonie (1965), sur le peintre Michel-Ange, efface entièrement son homosexualité, jusqu’à mettre en scène une histoire d’amour avec une femme, inventée de toute pièce. Dans les biopics plus récents, hormis Rocketman, qui aborde de manière plus extensive et directe la sexualité d’Elton John et l’impact de celle-ci sur sa vie et sa carrière, la plupart des biopics se contentent d’aborder la sexualité de manière prude et mesurée, à l’instar de Bohemian Rhapsody. Entre victimisation et effacement, les biopics baignent souvent dans les stéréotypes de notre société.
Inexactitudes historiques : choix artistique ou heurt à la mémoire ?
Les biopics se permettent souvent de grandes inexactitudes historiques, mais est-ce réellement problématique ?
D’une part, nous pouvons voir ces exagérations ou inexactitudes comme des stratégies de narration. Ces “erreurs” peuvent simplement servir le récit pour le rendre plus dynamique ou émotionnel pour les spectateurs. Nous n’attendons pas forcément d’un film une leçon d’histoire, mais une proposition artistique dont les personnages servent l’intrigue. Un exemple parlant est une scène de Bohemian Rhapsody, où Freddie Mercury (interprété par Rami Malek) annonce aux autres membres de Queen être atteint du sida pendant les répétitions du Live Aid (1985). En réalité, il n’apprendra être atteint de la maladie que deux ans plus tard. Mais cette inexactitude sert le récit en renforçant le caractère émotionnel et la légende autour de la performance de Queen au Live Aid, ici représentée comme les dernières retrouvailles du groupe avant la mort de Freddie. Ainsi, un film ne se raconte pas comme une vie : ellipses temporelles, simplifications et exagérations offrent des effets tragiques, émotionnels et grandioses au récit, et peuvent ainsi être nécessaires.
Cependant, le risque des exagérations réside dans le cas où l’histoire du protagoniste ne concerne pas seulement lui. En effet, malgré son succès critique et populaire, The Imitation Game, mettant en scène la vie d’Alan Turing et l’élaboration de la machine Enigma durant la Seconde Guerre mondiale, est truffé d’inexactitudes. Le film présente Alan Turing comme un génie ayant mis en place, seul, cette machine. En réalité, des centaines de scientifiques étaient impliqués dans cette découverte. Seuls 41% du film sont jugés fidèles à la réalité. Même si ces inexactitudes servent le récit du film, elles semblent tout de même véhiculer des approximations historiques occultant des centaines de héros de guerre ayant participé à cette avancée majeure.
Des histoires un peu trop romancées ?
Le cœur des biopics est de romancer les parcours de vie de personnes réelles ayant marqué la société. Mais lorsque ces personnages sont des tueurs en série par exemple, cette romantisation devient rapidement problématique, voire dangereuse. Les séries et films les mettant en scène sont souvent maladroits et, par des stratégies narratives, semblent parfois justifier ou créer de l’empathie pour ces personnages. Ce fut le cas pour le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, revenant sur la vie de Ted Bundy, tueur en série américain ayant fait 36 victimes. Les choix narratifs axés sur sa relation amoureuse avec sa compagne semble rendre le personnage touchant pour certains. Romantiser des histoires comme celles-ci est un réel danger lorsque les réalisateurs font de tueurs en série de potentiels objets d’adoration et d’empathie pour certains spectateurs. Ce biais est renforcé par le choix du casting. En effet, des acteurs considérés comme des modèles de beauté ou de gentillesse ont souvent été choisis pour interpréter des tueurs en série. Ce fut le cas pour Evan Peters interprétant Jeffrey Dahmer dans Dahmer. Ce choix peut renforcer une certaine fascination de la part des spectateurs pour ces personnages, phénomène qui a pu être observé sur TikTok après la sortie de la série.
La recette pour un bon biopic ?
Malgré ce portrait négatif des biopics, certains se démarquent par leur justesse, et rendent pleinement hommage au personnage qu’ils dépeignent. Les essais réussis, selon moi, comme Amadeus (Milos Forman), I’m Not There (Todd Haynes) ou encore Rocketman (Dexter Fletcher) en sont la preuve. Ces films ont réussi à adopter un angle précis et une vision artistique, les rendant dynamiques et brisant l’aspect monotone d’un récit chronologique. Les réalisateurs ont pu explorer les différentes facettes du personnage en question, sans contraintes externes (entourage du personnage). Quant aux inexactitudes historiques et la romantisation, elles sont parfois présentes mais restent, pour de nombreux observateurs, acceptables et sans danger.
Other posts that may interest you:
Discover more from The Sundial Press
Subscribe to get the latest posts sent to your email.